Quand on pense aux lancements spatiaux, on se dit souvent : « Allez, mettez un moteur plus puissant, et c’est réglé ! »
Mais la réalité est bien plus complexe, et tout repose sur les lois implacables de la physique.
La barrière de la première vitesse cosmique
Pour placer un objet en orbite, il faut atteindre la première vitesse cosmique, soit environ 7,9 km/s (soit 28 440 km/h !).
Ça peut sembler gérable, mais voici le hic : l’énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse.
Autrement dit, si vous doublez la vitesse, vous avez besoin de quatre fois plus d’énergie.
Et pour une fusée, l’énergie, c’est du carburant.
Plus d’énergie signifie plus de carburant, ce qui augmente la masse… et donc il faut encore plus de carburant pour soulever cette masse supplémentaire.
C’est un cercle vicieux !
C’est pour ça que les fusées sont des géants de métal, mais que leur charge utile (satellites, sondes, etc.) représente souvent moins de 2 à 3 % de leur masse totale au décollage.
Par exemple, la Saturn V, qui a envoyé les astronautes sur la Lune, pesait 2 950 tonnes, dont seulement 140 tonnes étaient la charge utile ! (plus d’infos)
Et le rêve de l’avion spatial ?
L’idée d’un « avion spatial » semble séduisante : décoller d’une piste, prendre de la vitesse et filer dans l’espace.
Mais là encore, la physique vient jouer les trouble-fêtes.
Les moteurs à réaction classiques tirent leur énergie du carburant combiné à l’oxygène prélevé dans l’air.
Plus la vitesse augmente, plus l’air entrant dans le moteur apporte de l’énergie cinétique.
À des vitesses élevées, cette énergie devient si importante qu’elle rivalise avec celle produite par la combustion du carburant.
Résultat ? Le moteur dépense plus d’efforts à ralentir cet air qu’il n’en gagne en poussée.
C’est comme pédaler à vélo contre un mur invisible !
Des projets comme le X-37B de la NASA ou le SpaceShipOne ont exploré cette idée, mais ils restent limités.
Pour l’instant, ces « avions » ne font que frôler l’espace (environ 100 km d’altitude) avant de redescendre.
C’est loin des orbites stables à 400 km et plus.
La physique rend ce concept trop inefficace pour un accès régulier à l’espace. (découvrez le X-37B)

La solution : les fusées multiétagées
Alors, comment fait-on ? La réponse, ce sont les fusées multiétagées.
Ces engins sont conçus pour larguer les réservoirs et moteurs devenus inutiles à chaque étape.
Cela réduit la masse au fur et à mesure.
Par exemple, la fusée Falcon 9 de SpaceX utilise deux étages : le premier se sépare après avoir donné l’impulsion initiale, et le second termine le travail.
Certains étages sont même récupérés pour être réutilisés, une révolution économique dans l’industrie spatiale.
Sans ce système, le coût et la complexité des lancements seraient prohibitifs. (en savoir plus sur Falcon 9)
Une lutte contre la gravité et la physique
Chaque lancement spatial est une bataille acharnée, non seulement contre la gravité terrestre, mais aussi contre les lois de la vitesse et de l’énergie.
C’est un équilibre délicat entre puissance, masse et ingénierie.
Et pourtant, ce défi constant a permis à l’humanité de poser le pied sur la Lune, d’explorer Mars et de connecter le monde via des satellites.
La prochaine étape ? Peut-être des innovations comme les lanceurs réutilisables ou les ascenseurs spatiaux.
Mais pour l’instant, la physique reste la reine de l’espace. (explorez le programme Artemis)
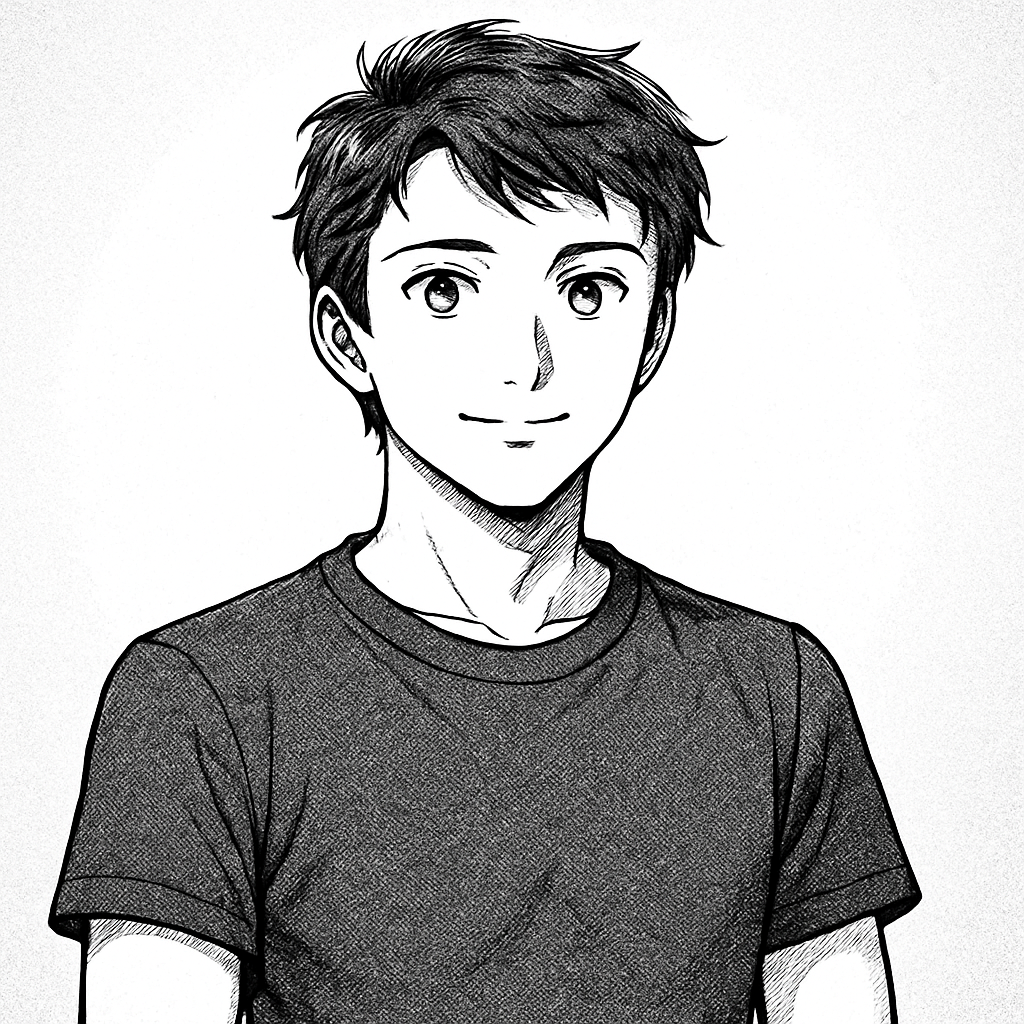
Alexis, rédacteur de Seek & Look. J’explore et décrypte l’actualité scientifique, les découvertes marquantes et les innovations qui façonnent notre avenir.

